
Pourquoi ou comment ?
Imaginons… vous confiez une tâche à un collègue ou à un membre de votre équipe. Tout est clair. Vous avez pris le temps de préciser le contexte et le point de sortie, le résultat attendu.
Au cours d’un point d’étape, vous vous apercevez que votre collègue/collaborateur fait fausse route, car il n’a pas pris les bonnes données de départ. C’était pourtant évident – pour vous – qu’il ne fallait pas prendre ces données.
Face à cette situation qu’avons-nous tendance à faire ? Quelle est la question que l’on pose souvent ? « Mais pourquoi as-tu pris ces données ?!! Ce ne sont pas les dernières. Pourquoi tu n’as pas vérifié ? ».
Au-delà des mots employés (Pourquoi), ce qui transparaît dans le ton employé est : « pourquoi as-tu fait cela…imbécile ! »
Face à une erreur, un échec, nous posons souvent la question « Pourquoi ? ». Or poser cette question c’est renvoyer au passé, un passé qui ne pourra pas être changé.
Une fois l’erreur constatée, qu’est-ce qui est le plus important pour nous ? Le passé ou le futur ? Savoir pourquoi la personne a fait cette erreur (passé) ou savoir comment elle va s’organiser pour rectifier l’erreur et arriver ainsi au résultat attendu (futur) ?
Notre système éducatif français privilégie la recherche des erreurs, c’est le syndrome du « stylo rouge » ou, en entreprise, de la recherche du coupable.
Nous consacrons parfois plus de temps à comprendre d’où vient l’erreur que de temps à trouver une solution.
Notre croyance est que la connaissance des causes de l’erreur nous renseignera forcement sur la solution à adopter. Ce qui n’est pas toujours le cas.
Si une personne qui ne sait pas nager se retrouve dans une piscine et commence à couler, quel intérêt de lui demander pourquoi elle ne sait pas nager ou pourquoi elle est dans cette piscine ? Le plus important est de s’intéresser à comment nous allons faire pour la sortir de là ! De la même façon, je m’aperçois que le pneu de ma voiture est crevé. Qu’est-ce qui est le plus utile ? Me demander pourquoi ce fichu pneu est crevé ou comment je vais faire pour le remplacer ?
Dans le cas du dossier confié à un collègue ou à un collaborateur que faire ?
- Partager notre constat, sans juger ni rabaisser : les données utilisées ne sont pas les bonnes.
- Évoquer les conséquences directes et objectives sur la fiabilité du résultat
- Rappeler l’objectif en termes de résultat attendu et de délai imparti
- Demander à la personne comment elle va s’organiser pour atteindre l’objectif et si elle a besoin de notre aide
Lors de l’étape 4, il est probable que la personne aille d’elle-même dans le passé pour y chercher les raisons de son erreur et qu’elle tente alors de se justifier.
La bonne posture à adopter est d’être constructif et de guider la personne vers la recherche de solutions : « d’accord, tu as vu d’où vient l’erreur. Maintenant, comment vois-tu les choses ? que vas-tu faire ? comment vas-tu t’organiser ? ». Puis, plus tard, lors d’un débriefing « que retiens-tu de ce qui s’est passé ? Que feras-tu de différent la prochaine fois ? ».
Procéder ainsi c’est accepter le droit à l’erreur (non répétitive) et favoriser le « test & learn » source de développement et de responsabilisation.
Un dernier élément qui a son importance. Poser la question « pourquoi tu as fait cela ? », c’est infantiliser la personne, la renvoyer au temps de l’école primaire où elle se faisait réprimander par sa maîtresse ou son maître d’école.
Avec un risque de provoquer chez elle des mécanismes de défense comme la recherche d’excuses, des plaintes, un désengagement voire de l’agressivité. Bref, une perte d’énergie, d’efficacité et de temps pour tout le monde.
En résumé face à une erreur, le futur plutôt que le passé, le « comment » plutôt que le « pourquoi ».
Paul Simoes, manager et coach certifié chez haxio
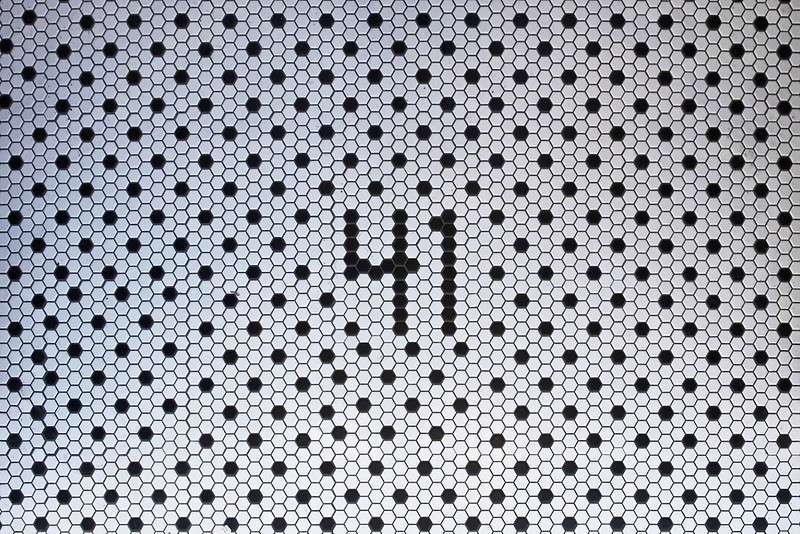



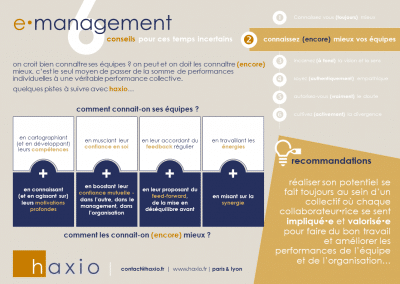

![abcd’R | spécial [dé]confinement](https://www.haxio.fr/wp-content/uploads/2020/05/abcdR-image-de-couverture-1080x675.png)
