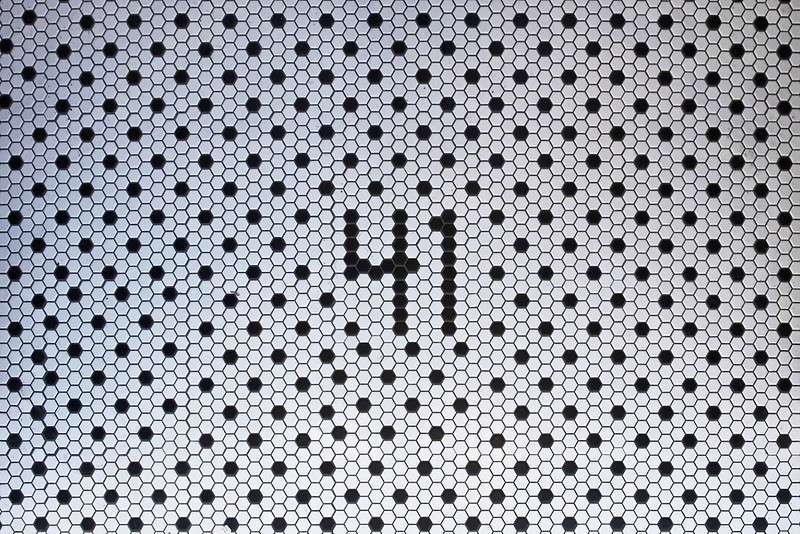
la crise, c’est (aussi) l’occasion à saisir
Vous avez aimé Paris désert ? Vous l’adorerez de retour aux affaires.
Bon autant l’avouer : ce n’est pas encore ça. Pour cette rentrée, l’avant dernière de l’année (nous en aurons au moins trois en 2020 : janvier, juin, septembre), on en est encore au stade des répétitions. Qu’on ne se mente pas : elles risquent de durer. Il y a des voitures – mais davantage de vélos. Il y a des enfants devant les écoles – mais pas tous les enfants, ni devant toutes les écoles. Il y a des collaborateurs au bureau – mais ce ne sont pas les mêmes qu’hier, ni les mêmes que demain, un roulement secret s’opère dont les règles restent floues, entre celles et ceux qui ont peur des transports en commun, celles et ceux qui ont des enfants à demeure, celles et ceux qui ont basculé avec béatitude dans le 100% télétravail… et rêvent d’y rester… Le métro fonctionne – mais certaines stations, ignorant la fin du confinement, demeurent fermées. Le masque est obligatoire – mais sous terre ou dans certains magasins : dans les rues, les parcs, ils ont disparu. Avez-vous remarqué ? Quand on cherchait des masques, on n’en trouvait pas. Maintenant qu’on en trouve partout, on les cherche aussi partout…
Alors c’est ça le monde d’après ? Une racine carrée du monde d’avant, avec de rares masques, de nombreux vélos et des restaurants dont les terrasses fleurissent sur les trottoirs comme des champignons après l’orage ? On ne le sait pas ou plutôt : on ne le sait pas encore. Le CAC 40 remonte mais moins vite que le nombre de licenciements et de faillites d’entreprises. Les déficits et les dettes, formant montagnes à rembourser, donnent le vertige. Les recrutements sont rares, les entreprises qui recrutent incertaines de l’avenir, du leur, de leur trajectoire et de celle de leur secteur. Quelque chose se passe au niveau de la Société, des sociétés et des individus qui reste à écrire, entre reprise, réforme, réinvention ou révolution. Plus que jamais, on aime se rappeler le mot de John F Kennedy : « écrit en chinois, le mot crise est composé de deux caractères : l’un représente le danger et l’autre l’occasion à saisir ».
On a (bien) pris la mesure du danger : il reste maintenant à trouver et à saisir les occasions…




